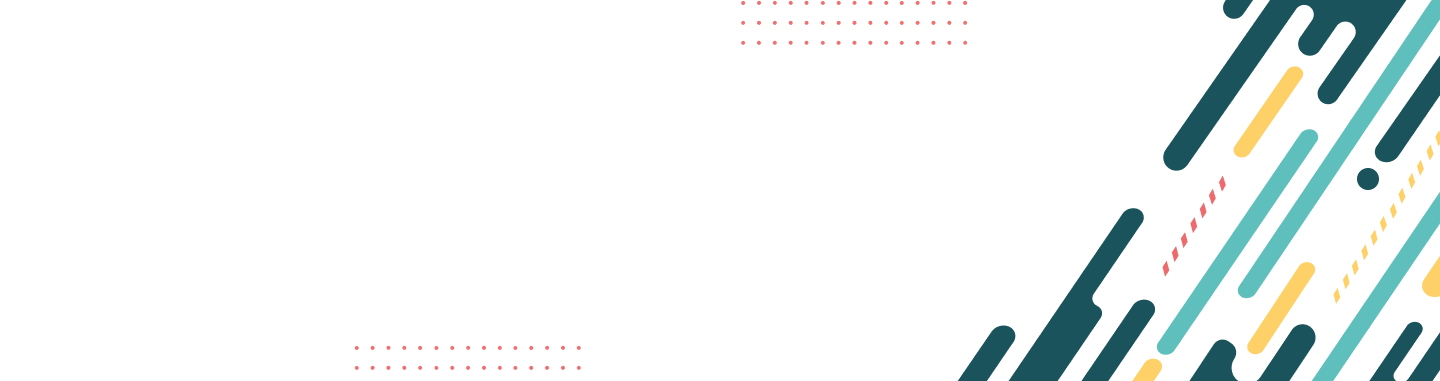Objectifs
- Permettre aux participants de comprendre à partir des états financiers les risques auxquels sont exposés les établissements de crédit et d’analyser les composantes de leur rentabilité. Cette analyse prend en compte les différents métiers et les stratégies de ces établissements.
- Maîtriser les fondements des grands principes de classification, d’évaluation et d’enregistrement des grandes familles d’opérations en fonction des règles comptables IFRS 9 dans le cadre des principaux métiers.
- Connaître le contenu des états financiers publiables et savoir les analyser, en particulier leurs annexes (document d’enregistrement universel ou de référence).
- Comprendre le lien entre les états financiers et les informations prudentielles relatives aux risques inclus dans le document de référence (pilier 3 du dispositif Bâle III).
- Acquérir des éléments de méthodologie d’analyse ou d’investigation à utiliser lors des analyses ou des contrôles sur place (par la BCE ou par l’ACPR selon la taille des banques).
Animateur(s)

Jean-Marie LAY
- Comptabilité, contrôle de gestion et fiscalité.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
- Marchés, produits et services financiers.
- Analyse financière.
Programme
1ÉCONOMIE ET RISQUES D’UNE BANQUE – LIEN AVEC LE REPORTING COMPTABLE ET PRUDENTIEL
Rappel de l’économie des activités bancaires et des différents objectifs de l’analyse financière.
Rappel des informations disponibles et d’éléments de méthodologie.
Présentation des concepts fondamentaux avec des comptes simplifiés.
Notion d’effet de levier.
Actualisation des flux futurs et notion de « dé-actualisation » – notion de taux d’intérêt effectif (TIE).
Prise en compte de la juste valeur en l’absence de détention durable.
Cadre conceptuel des normes comptables IFRS 9.
Synthèse de la norme comptable IFRS 9 et de la comptabilité de couverture.
Rappel des principes et règles nécessaires pour l’analyse :
- La présentation des différents postes du bilan et du compte de résultat.
- Les méthodes comptables utilisées en fonction de la nature des instruments financiers (basiques ou non) et du modèle de gestion (détention durable ou non).
- La relation emplois-ressources (la banque travaille avec l’argent des autres).
- L’explication des agrégats comptables en liaison avec l’activité économique des établissements de crédit.
Illustration de la comptabilisation à la juste valeur.
Présentation de synthèse des normes comptables françaises (comptes sociaux) et de la logique sous-jacente (pérennité des personnes morales, principe de prudence, etc.).
Identification des points clés ou sensibles utiles pour procéder à une analyse financière pertinente.
Dépréciation des actifs financiers en fonction du niveau de risque de crédit et notion de pertes attendues (expected loss – EL) :
- Statut 1 : risque de crédit faible.
- Statut 2 ; dégradation significative du risque de crédit.
- Statut 3 : actif douteux ou en défaut prudentiel.
Dépréciation et coût du risque en compte de résultat.
Approche prudentielle :
- Approche stressée à un an.
- Pérennité des capitaux propres et absorption des pertes.
- Pertes attendues à un an et pertes non attendues.
- Pertes non provisionnées en comptabilité (risque de marché et risque opérationnel).
2ANALYSE DU BILAN ET PASSAGE AUX PRINCIPAUX RATIOS PRUDENTIELS
La logique et le processus de détermination des fonds propres prudentiels :
- Risque de crédit et de solvabilité.
- Valeur liquidative (actif net comptable) stressée à un an.
- Dettes subordonnées éligibles.
- Couverture des pertes non attendues (non provisionnées en comptabilité).
Les niveaux de fonds propres et de coussins (buffers) : pilier 1 et pilier 2.
Lien entre la pondération des actifs, le niveau de fonds propres nécessaires (ratio de solvabilité) et la quantité de pertes non attendues à couvrir.
Risque de crédit et risque de contrepartie.
Logique des approches de la pondération des risques :
- Approche standard (forfaitaire ou fondée sur la notation externe) du risque de crédit.
- Approche modélisée du risque de crédit fondée sur la notation interne des contreparties (Internal rating based – IRB).
- Approche standard ou modélisée des risques non provisionnés (de marché ou opérationnel).
Lien entre le niveau de risque et la rentabilité attendue d’un crédit.
Bilan et compte de résultat par métier ou domaine – impacts sur le ratio de solvabilité et le rendement des fonds propres alloués.
Le lien entre les besoins en fonds propres et la rentabilité des banques.
Définition des différents risques :
- Risques de crédit.
- Risques de marché.
- Risques opérationnels.
- Autres risques.
3LES PERSPECTIVES PRUDENTIELLES
Illustration au moyen d’un exemple de la logique du traitement comptable et du traitement prudentiel d’une opération de pension livrée.
Notion de risque de contrepartie.
Principales évolutions depuis 2025 (règlement européen CRR 3 transposant la « finalisation de Bâle 3) :
- Risque de crédit.
- Risque opérationnel (approche standard révisée unique).
- Risque de marché (FRTB).
- Ratio de levier.
4SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse des deux journées.
Évaluation de la formation.
Public et pré-requis
Participants
- Collaborateurs des services en charge des études comptables, du contrôle comptable, du contrôle de gestion, de l’évaluation du risque de crédit et de l’audit interne des établissements de crédit.
- Collaborateurs des agences de notation.
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en PowerPoint.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Synthèses.
Connaissances requises
- Bases de comptabilité bancaire.
Dates
| Dates | Localisation / Modalité | Animateur(s) | |
|---|---|---|---|
|
Du 18/05/2026 au 19/05/2026 |
Paris | Jean-Marie LAY | S'inscrire |
|
Du 18/05/2026 au 19/05/2026 |
Distanciel | Jean-Marie LAY | S'inscrire |
|
Du 10/09/2026 au 11/09/2026 |
Paris | Jean-Marie LAY | S'inscrire |
|
Du 10/09/2026 au 11/09/2026 |
Distanciel | Jean-Marie LAY | S'inscrire |